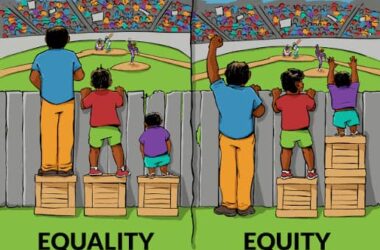En relisant ce roman très “costaud” de Sony Labou Tansi, je me suis retrouvé dans le Mali d’hier et d’aujourd’hui. La monstrueuse caricature d’une dictature tropicale avec ses valets, soldatesque vivant sur l’habitant, fabriquant de terreur, inventeur de complots, faisant régner la terreur. Il s’agit tout simplement, comme le dit Achille Mbembe, de l’administration d’une violence lapidaire et improductive. Comment, en effet, explorer et comprendre le sens de cette violence à l’état brut, cette violence massive au Centre du Mali après les épisodes guerriers au Nord de la République ? Au Mali, les massacres se suivent et se ressemblent de Sobané Da à Ogossagou en passant par tous les autres trous noirs de cette violence écarlate. “La violence, en effet, selon Achille Mbembe, a une épaisseur humaine telle qu’il est difficile d’en parler en faisant l’impasse sur des interrogations fondamentales, que celles-ci portent sur les problèmes de légitimité, d’éthique ou, plus simplement, de construction de l’ordre social. Pis, elle produit la mort : à petit feu ou, souvent, à forte dose. Elle constitue donc un aspect structurant de la postcolonie. Dans un sens, on doit dire de la postcolonie qu’elle est un régime particulier de production de la mort et d’invention du désordre”. Il est évident que cette violence-là n’est pas spécifique à l’Afrique, ni au Mali, les exemples dans l’histoire de l’Amérique Latine ou de l’Asie, voire même de l’Europe, sont légion. Ce qui l’est moins, spécialement, dans le cas du Mali, c’est sa privatisation et son hétéronomie au point qu’elle délégitime chaque jour davantage, ceux-là qui avaient l’usage légitime de cette violence.